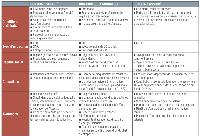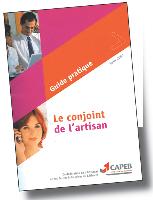Femme d'artisan, un métier à part entière
Longtemps, le conjoint de l'artisan a travaillé sans reconnaissance. La loi du 2 août 2005 l'a contraint à opter pour un statut avant le 1er juillet 2007, date limite pour se mettre en règle. En découlent des conséquences juridiques, mais aussi sociales.
Je m'abonne
@ SPREUX / ESPACE PHOTOS
La loi du 2 août 2005 a permis à Maguy Desgardin, qui travaille avec son époux plombier-chauffagiste, de choisir le statut de conjoint collaborateur.
Après 16 ans de vie commune et autant d'années passées à travailler dans l'entreprise familiale, une femme d'artisan se retrouve privée de ressources et s'aperçoit qu'elle n'a jamais cotise pour sa retraite. Ce cas n'est pas isolé. Et il aura fallu deux lois pour trouver une issue à cette situation dramatique. Un premier texte, voté en 1982, permettait au conjoint de choisir un statut juridique. Mais son caractère facultatif l'a rendue peu efficace. Un défaut auquel la loi du 2 août 2005, dite «loi en faveur des PME», a remédié en contraignant les conjoints d'artisans à déclarer un statut et à cotiser pour leur retraite avant le 1er juillet 2007. Jusqu'à cette date limite, l'épouse, qui n'avait pas choisi de statut ni cotisé pour ses vieux jours, n'avait donc acquis aucun droit, même en cas de divorce ou de décès de l'artisan avant l'âge de la retraite.
Si le nombre de conjointes en difficulté est impossible à chiffrer, il n'est, en tout cas, pas négligeable. «A chaque réunion d'information, à raison d'une par mois pendant un an avant l'adoption de la loi du 2 août 2005, nous avions dans la salle au moins un cas semblable, relate Roselyne Lecoultre, présidente de la Commission nationale des femmes d'artisans pour la Capeb et l'UPA. Les femmes d'artisans réalisaient douloureusement qu'elles avaient travaillé toute leur vie, mais qu'elles n'auraient rien pour leurs vieux jours.»
Pourtant, pendant longtemps, l'activité d'une entreprise artisanale a reposé en grande partie sur l'aide familiale. Même si, aujourd'hui, celle-ci est moindre, le conjoint est resté fidèle au poste dans la plupart des cas. Selon Roselyne Lecoultre, elle-même conjoint salarié de l'entreprise de menuiserie-charpente de son mari, on estime ainsi à 80% la proportion de conjoints travaillant dans l'entreprise, soit 600 000 personnes, principalement des femmes.
«Notre groupe de travail préparatoire à l'élaboration de la loi du 2 août 2005 a réellement pris conscience de l'ampleur de la tâche réalisée par les épouses. Ainsi, leurs compétences, notamment informatiques, ont largement évolué depuis quelques années. Elles s'occupent en général de la gestion et de la comptabilité de l'entreprise, des relations avec les banques et les assurances, ainsi que des salaires», ajoute Roselyne Lecoultre.
Des «travailleuses invisibles»
Bien que nombreuses, les épouses d'artisans ont longtemps été considérées comme des «travailleuses invisibles». Leur labeur était assimilé seulement à une entraide conjugale, sans rémunération, sans pouvoir sur l'entreprise et sans couverture sociale ni droit à la retraite. «C'était une situation injuste et dévalorisante, estime Annie Deudé, présidente de la fédération Actif (Associations des conjoints des travailleurs indépendants), qui défend notamment les compagnes des artisans. Elle était due à une combinaison de paramètres, tels que le manque d'informations ou la frilosité du conjoint. En outre, les comptables affirmaient que leur accorder un statut coûtait trop cher à l'entreprise. Une véritable aberration.»
Une première étape est donc franchie quand, en 1982, la loi reconnaît le problème et permet au conjoint qui le souhaite de choisir un statut juridique. «Mais à l'époque, les mentalités étaient différentes: on parlait beaucoup moins de la retraite, souligne Roselyne Lecoultre. Les artisans n'avaient pas pris conscience qu'il fallait s'en constituer une et encore moins une pour leur épouse.» Résultat: en 2004, seuls 20% des conjoints d'artisans avaient choisi cette solution, selon les chiffres de la Capeb. Un taux qui s'élève à 30% dans le secteur du bâtiment.

Témoignage
Ghislaine Laporte, conjointe collaborateur dans une entreprise de plomberie à Toulon
«Il n'était pas concevable pour moi de ne pas avoir de statut»
Depuis 27 ans, Ghislaine Laporte travaille au côté de son mari. Elle s'occupe des tâches administratives et de la gestion du personnel quand l'activité de l'entreprise nécessite d'en recruter temporairement. «Je ne pouvais pas concevoir de ne pas avoir de statut Au début, j'étais conjointe salariée. J'étais déclarée à mi-temps, mais cela coûtait cher à l'entreprise en charges salariales», explique-t-elle. C'est pourquoi elle opte, en 1 998, pour le statut de conjoint collaborateur.
Pour ne pas entamer le capital retraite de son mari, ses cotisations d'assurance vieillesse correspondent au tiers du plafond de la Sécurité sociale, soit 10700 euros par an. Pour elle, «le profit est inexistant. Mes cotisations étant très faibles, le montant de ma retraite le sera mathématiquement Heureusement, j'ai été salariée pendant 25 ans! Du coup, cette loi donne l'impression de cotiser pour rien». Elle admet toutefois qu'elle tiendrait un autre raisonnement si elle était plus jeune.
Repères
- RAISON SOCIALE
Pierre Laporte Plomberie
- VILLE
Toulon (Var)
- DIRIGEANT
Pierre Laporte
- EFFECTIF
2 personnes
- CA
NC
Trois statuts au choix
C'est le cas de cette femme travaillant avec son mari dans une entreprise de climatisation, à Hyères (Var) . En charge du secrétariat, elle n'a pas attendu la loi du 2 août 2005 pour choisir son statut. Dès 2004, elle opte pour celui de conjoint collaborateur qui permet, à condition d'être marié, d'exercer une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, sans percevoir de salaire, mais en cotisant pour bénéficier d'une retraite. «Je voulais officialiser mon statut dans l'entreprise», explique-t-elle. Son déclic? «J'ai vu de nombreux cas difficiles autour de moi.» Malheureusement, peu suivent son exemple.
La loi du 2 août 2005, mise en place par Renaud Dutreil, alors ministre des PME, finalise cette reconnaissance: elle oblige les conjoints d'artisans non seulement à déclarer un statut parmi les trois existants - salarié, collaborateur et associé - avant le 1er juillet 2007, mais aussi à cotiser pour leur retraite (voir l'encadré «Les trois statuts du conjoint»). Une loi très attendue, comme le confirme Maguy Desgardin, présidente de la commission des femmes d'artisans de la Capeb de Seine-Maritime. «Etant moi-même mariée à un plombier- chauffagiste implanté à Yvetot (Seine-Maritime), je voulais choisir un statut depuis longtemps. Mais la société étant une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ndlr), cela éliminait automatiquement celui de conjoint collaborateur.» Aussi, dès la signature des décrets, en décembre 2006, Maguy Desgardin et son époux ont-ils pris contact avec la chambre de métiers de leur département pour s'inscrire. «Si on se déplace, les démarches ne prennent qu'une journée», précise-t-elle. La déclaration doit ensuite être adressée au centre de formalités des entreprises. Avec ce statut, le conjoint peut réaliser de nombreux actes de gestion courante, mais sans engager de façon trop importante la responsabilité juridique de l'entreprise et de son dirigeant. En contrepartie, ses biens propres sont protégés.
Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque l'on choisit le statut d'associé. Le conjoint participe alors à la constitution du capital social de l'entreprise en acquérant des parts. Selon les statistiques 2004 de la Capeb, seules 9% des conjointes du BTP ont d'ailleurs choisi ce statut. «Il concerne assez peu les entreprises artisanales», souligne Damien Prum, expert-comptable en charge du marché des petites entreprises chez KPMG. A l'inverse, le statut de conjoint salarié connaît un net succès. «Il est plébiscité par la jeune génération, plus autonome, note Roselyne Lecoultre. Aujourd'hui, les femmes d'artisans ne conçoivent pas de travailler sans percevoir un salaire. Et puis, c'est aussi le statut qui leur garantit le plus de sécurité.»
Depuis le 1er juillet, les conjoints qui ne se sont pas décidés pour un statut sont donc dans l'illégalité. Et ils sont encore nombreux, à l'image de Sylvie Guillard. Assimilée fonctionnaire, elle travaille à 80% de son temps comme ouvrier d'Etat au ministère de la Défense, mais consacre également une après-midi par semaine à l'entreprise de son mari, plombier- chauffagiste. «Si la Capeb ne m'avait pas contactée en juin dernier, je n'aurais pas su que j'avais obligation de me déclarer», explique-t-elle. D'ailleurs, elle en est encore aux démarches préliminaires pour demander l'accord du ministère de la Défense pour se déclarer comme conjoint collaborateur. C'est en effet le seul statut qui l'autorise à concilier une activité professionnelle avec celle qu'elle occupe déjà. Or, comme tient à le rappeler Annie Deudé, de la fédération Actif, «un conjoint non mentionné est directement requalifié en conjoint salarié par l'Urssaf lors d'un contrôle, même si ce n'est pas le meilleur statut. De plus, l'entreprise devra payer une amende correspondant à un rattrapage de charges sur les trois dernières années». Aussi est-il primordial de ne pas attendre qu'un contrôle survienne (voir l'encadré Juridique ci-dessus).

Surtout que la loi en faveur des PME, pour laquelle de nombreuses organisa tions (Capeb, UPA, Actif...) se sont battues durant des années, comporte plusieurs atouts. Outre un statut juridique et fiscal, elle apporte de fait une reconnaissance sociale, même si les conjointes ne l'ont pas attendu pour assumer leur rôle. «Très souvent, les artisans reconnaissent que, sans leur épouse, ils n'auraient pas pu développer leur entreprise de la même manière», affirme ainsi Annie Deudé. En revanche, dans certains secteurs, quelques-unes avaient du mal à trouver leur place par rapport aux ouvriers. «C'est la fameuse image de la femme du patron», pas forcément professionnelle. Heureusement, cette idée toute faite disparaît avec la jeune génération. Les moins de 40 ans disposent généralement d'une meilleure formation» , souligne la présidente de la fédération Actif.
A LIRE
GUIDE PRATIQUE
Cet ouvrage retrace les droits, obligations et démarches nécessaires au rattachement à l'un des trois statuts prévus pour le conjoint d'artisan: collaborateur, salarié et associé. Cotisations, prestations, responsabilité et cas particuliers (Pacs, concubinage) y sont abordés dans un langage clair et accessible.
Le conjoint de l'artisan, Capeb, juin 2007, 5 euros. Disponible auprès des Capeb départementales et des UPA.
Juridique
Les sanctions si vous ne vous êtes pas déclaré
«On ne fait pas de redressement sur l'année en cours, mais sur les trois années précédentes, explique David Chouraki, sous-directeur à l'Urssaf du Var. Les sanctions ne pourront donc pas commencer avant 2008. Entre-temps, nous assurons un rôle d'information sur la déclaration obligatoire du statut du conjoint, en demandant aux artisans de régulariser la situation auprès de leur centre de formalités des entreprises. S'ils ne l'ont pas fait avant 2008 - nous pouvons contrôler les immatriculations -, nous reprendrons contact avec eux.»
Le risque encouru? Se voir accusé de travail dissimulé. Le redressement correspond alors au montant des cotisations «échues», c'est-à-dire non versées quand elles auraient dû l'être, avec la éventuellement des majorations de retard.
Les avantages de la loi
«Maintenant, je peux dire que j'ai un métier et sortir de l'anonymat», renchérit Maguy Desgardin, conjointe d'un plombier-chauffagiste. Infirmière pendant 30 ans, elle a vécu une véritable rupture en venant travailler au côté de son mari: «J'ai eu l'impression de me retrouver au Moyen Age, quand les femmes étaient sous l'influence de leur époux», raconte-t- elle.Avec des répercussions jusque dans sa vie personnelle, lorsqu'elle fait une demande de crédit pour une voiture, et qu'elle s'aperçoit qu'il n'existe aucune case correspondant à sa situation. «Le choix d'un statut est un acquis social notable», conclut-elle. Par ailleurs, la reconnaissance de leur rôle dans l'entreprise pousse les femmes à davantage se former. «Elles demandent de plus en plus à avoir accès à des formations longues et diplômantes, comme le BCCEA (Brevet de collaborateur de chef d'entreprise artisanale) ou le GEAB (Gestion des entreprises artisanales du bâtiment)», observe Annie Deudé. Elles entrent ainsi dans un cercle vertueux qui leur permet d'accroître leurs connaissances théoriques et pratiques, donc de participer au développement de l'entreprise.
La loi du 2 août 2005 ouvre également la possibilité au conjoint qui le souhaite de poursuivre l'activité de l'entreprise sans le dirigeant (dans le cas, notamment, de son décès). Il bénéficie alors d'un délai pour se mettre en conformité avec les obligations requises en matière de qualification professionnelle. «Auparavant, pour garder l'entreprise, le conjoint était dépendant d'un salarié qui avait la qualification requise», rappelle Roselyne Lecoultre. Ce délai, d'une durée de trois ans, s'applique si le conjoint s'engage dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE).
La récente loi n'a toutefois pas résolu tous les problèmes. Elle présente en effet des inconvénients et des limites. Premier bémol, et non des moindres, le choix d'un statut oblige les entreprises artisanales à cotiser pour le conjoint. «Néanmoins, souligne Roselyne Lecoultre, le calcul de la cotisation est révisable tous les ans. Cela permet de tester la formule qui convient le mieux.» Par ailleurs, il existe des solutions pour alléger la transition. L'entreprise peut ainsi bénéficier de reports et étalements de cotisation.

Annie Deudé, présidente d'Actif
Les conjointes contribuent activement à développer l'entreprise artisanale.

Sylvie Guillard, qui travaille une après-midi par semaine avec son mari, a entamé les démarches pour choisir son statut.
Des catégories exclues
La loi exclut également certaines catégories. C'est le cas des pacsés et des concubins qui ne peuvent pas adopter le statut de collaborateur. Même si les concubins ont tout de même le choix entre être salariés ou associés. «C'est notre prochain cheval de bataille, confirme Roselyne Lecoultre, notamment parce que la nouvelle génération est beaucoup concernée.»
Autre écueil: la loi ne résout pas non plus le problème lié au statut de conjoint salarié si celui-ci se retrouve privé de son emploi, du fait, par exemple, des difficultés de l'entreprise. Selon Damien Prum, expert-comptable chez KPMG, rien ne garantit en effet qu'il pourra bénéficier de l'assurance chômage: «Dans les faits, on constate que la demande des conjoints salariés est assez souvent rejetée. Dans tous les cas, cela n'a rien d'automatique. Il est donc impératif de questionner l'Assedic qui va vérifier si le conjoint n'a pas trop de délégation de pouvoir, à travers la signature notamment.»
Par ailleurs, si la loi prévoit que le conjoint collaborateur peut racheter jusqu'à six années de cotisation pour toucher une retraite à taux plein, le décret en déterminant les conditions d'application n'est toujours pas paru et n'est pas, pour l'heure, à l'ordre du jour du Conseil d'Etat. Un élément important, puisqu'il devrait permettre de racheter les six années de manière échelonnée. Néanmoins, pondère Annie Deudé, «les rachats de cotisation seront très chers, même s'ils seront déductibles des charges de l'entreprise. Cela pourra s'appliquer aux personnes qui auront un ou deux ans à rattraper, mais pas six.»
Malgré ces imperfections, cette loi a le mérite d'exister. «Même si le conjoint est aussi connu des clients, fournisseurs et partenaires que le chef d'entreprise, cette collaboration de tous les instants est enfin reconnue à sa juste valeur», conclut Annie Deudé.